Des écoles publiques à deux vitesses
L’émergence d’un système de santé à deux vitesses est une ignominie. Si notre richesse collective ne peut assurer un partage égal des services essentiels, c’est qu’alors le contrat social n’est que de la poudre aux yeux, une superbe illusion de la classe dirigeante qui se moque du tissu moral. Quand cette disparité touche les enfants, nous tendons à une insensibilité funeste. Le secteur de l’éducation a toujours été marqué par une disparité entre les écoles privées et publiques. Les écoles privées s’étant établies les premières, on a accepté l’écart comme un droit acquis. Mais quand la déchirure divise le secteur public, il faut resserrer les rangs. …
Plusieurs facteurs contribuent à discriminer les écoles publiques. Outre les disparités dans la taxe scolaire, les restrictions budgétaires obligent les écoles à se tourner vers d’autres sources de financement, décriées par les syndicats d’enseignants. Une étude réalisée par la Fédération canadienne des enseignants révèle que les écoles au pays amassent en moyenne 15 700 $ par année pour répondre à des besoins élémentaires comme l’achat de livres de bibliothèques et les programmes sportifs. Seule ombre positive au tableau, les écoles de langue française du Québec sont celles qui affichent le moins de publicité. Mais est-ce à dire que les écoles du Québec sont en voie de devenir les plus pauvres du Canada ?
Après le fiasco des commandites avec les multinationales de boissons gazeuses, dans lequel plusieurs écoles se sont fait prendre, les administrateurs scolaires se tournent maintenant vers les fondations d’école. À juste titre, plusieurs parents et experts reprochent aux gouvernements de se détacher de leurs responsabilités en matière d’éducation (Globe and Mail : Schools rely on the 4th r’: raising cash for basics). Mais on néglige de dénoncer les inégalités dans le financement des écoles des milieux nantis par rapport à leurs cousines plus pauvres. Je connais peu d’écoles qui arrivent à amasser 250 000 $, comme ce fut le cas d’une école secondaire de l’Ontario. Et que dire d’une école élémentaire de Vancouver qui, lors d’un encan et d’un gala dans un yacht club, a enrichi ses coffres de 50 000 $ !
Les tensions commencent à poindre avant même l’école. Conscients de l’importance des apprentissages en bas âge, les parents fortunés se précipitent sur les institutions préscolaires (The Houston Chronicle : Early education fast becoming the norm). Au Québec, on se dispute les garderies subventionnées par l’État, dont Christine met en doute la légitimité.
L’écart entre les riches et les pauvres n’a fait que s’accroître avec le désengagement de l’État vis-à-vis de ses responsabilités éducationnelles. Une partie de la note est reprise par les parents (The Times : Paying for public education). Mais si les administrateurs qui se sont dotés d’une fondation réussissent tant bien que mal à composer avec des écoles délabrées, la situation est certainement différente pour les autres.
Entre la Croix-Rouge et Centraide, les Québécois devront bientôt ajouter leur école de quartier à la liste des organismes auxquels ils font la charité. Les taxes scolaires ne suffisent plus : pour pallier le sous-financement chronique, les écoles tendent de plus en plus souvent la main à leurs voisins immédiats. (Le Soleil : Les classes du Québec en piteux état)
Inévitablement, certains administrateurs perdent la tête ou vendent leur âme au diable (c’est comme vous voulez). Perdu dans le désert, on est forcément attiré par les mirages. Sacco rapporte le cas flagrant d’une directrice qui a vendu la réfection de son école à des entrepreneurs locaux, moyennant publicité dans lesdits lieux. L’indignation de ce parent est cinglante :
Est-ce que je ne paie pas justement des impôts pour que mes enfants aient une école qui ne tombe pas en ruine. Est-ce que la seule solution était véritablement de vendre mes enfants à des entreprises privées!?! [...] Je n’accepte tout simplement pas que mes enfants soient exposés à cette théorie sociétale selon laquelle, le monde n’appartiendra jamais qu’aux entrepreneurs. Mme Lacroix n’a pas à jouer les entrepreneures, elle doit jouer le rôle de pédagogue!
Voilà ce qui se produit quand les enseignants donnent dans le missionnariat et que les écoles en sont réduites à mendier.
Par ricochet :
Financement et collégialité
Le financement privé de l’école publique
Le Canada investit moins en éducation
La caducité des commissions scolaires
L’école publique : pas dans les vitrines
Les enseignants font la charité aux écoles
Vous pouvez suivre les commentaires en réponse à ce billet avec le RSS 2.0 Vous pouvez laisser une réponse, ou trackback.

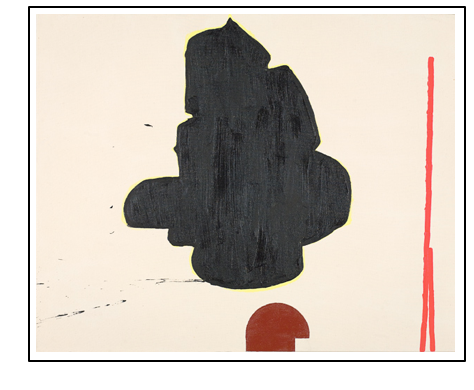
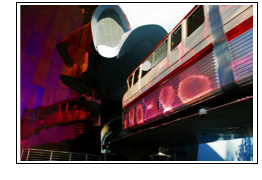

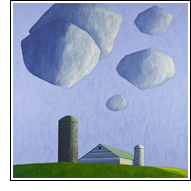

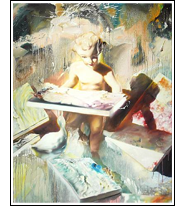


Je crois que François soulève un problème carrément plus criant que l’éternel débat entre les voix public et privé. Je me souviens il y a quelques années, le petit voisin vendant du papier hygiénique pour son école! Mais honnêtement je crois que la boîte a été ouverte. Même si le financement de l’école devient adéquat, ces fondations, à mon avis, demeureraient, le monstre a été créé.
Le monstre a été créé. Bien dit !
L’éducation et la santé engloutissent à elles seules plus de 60% de nos taxes et impots annuellement. Loin de nier les problématiques qui touchent ces deux secteurs, je me demande cependant quel taux devra etre consenti pour considérer que le financement est adéquat. Et si le problème était ailleurs aussi…
Je refuse de considérer l’éducation comme une dépense. Il s’agit évidemment d’un investissement. On ne fait pas la charité à nos enfants en leur donnant une éducation. On le fait sciemment, sachant que notre société s’en portera mieux, tant sur le plan économique que social. Tout le monde, en fin de compte, en bénéficie. Mais pour ça, il faut une vision à long terme. C’est la gestion des finances publiques à court terme, réélection oblige, qui sape le système d’éducation. Naturellement, il y a des limites au-delà desquelles le rendement ne justifie plus l’investissement collectif (pour utiliser un discours économique, puisque c’est toujours celui qui nous obsède). Mais je suis d’avis que nous sommes loin d’avoir atteint ce seuil.
Je suis d’accord avec le fond de ton dernier commentaire, François. Mon point ici, c’est qu’il ne suffit pas d’ajouter des millions pour améliorer les choses. Dans un sens, c’est probablement la chose la plus facile à faire car, comme tu le mentionnes, c’est souvent ce qui a le plus d’impact sur le résultat d’une campagne électorale, mais il faudra tot ou tard investiguer plus sérieusement des avenues complémentaires à celle-ci, autrement on risque de s’enliser dans un monde de pensée magique qui ne fera qu’augmenter notre frustration à l’égard du «vrai» monde.
Cela dit, je tiens à préciser que ce n’est pas une raison pour justifier, par exemple, que des gens travaillent 10h de plus par semaine pour les memes conditions. Ce qu’il faut explorer à mon avis, ce sont des réaménagements stucturels. Certes, ils ne sont pas évidents à investiguer car ils touchent généralement des façons de faire qui sont souvent profondément engrainées en nous. Je suis néanmoins d’avis que nous trainons tel un boulet de nombreuses structures qui, s’il y a 30-40 ans avaient tout à fait leur raison d’etre, l’ont moins aujourd’hui. Des structures qui drainent des fonds qui pourraient etre redistribués autrement et plus efficacement. Des structures qui ralentissent l’état d’avancement normal des choses compte tenu du contexte d’aujourd’hui. Des structures qui nous rendent prisoniers et qui limitent notre potentiel de créativité. Etc.
Évidemment, faire de telles remises en question, c’est souvent remettre en question des emplois. Ce n’est pas politiquement correct de faire ça car on peut donner l’impression que son travail est plus important que celui des autres. C’est une question fort délicate mais à laquelle nous devrons faire face un jour ou l’autre. D’ailleurs, je suis d’avis que nous avons de la difficulté à l’aborder en raison justement d’un modèle très profondément ancré en nous…
Je vous fait grace d’exemples. Pour le moment en tout cas. Vous avez probablement déjà une idée assez juste de ce à quoi je fais référence…
Tu as tout à fait raison, Stéphane, dans la mesure où ton analyse est plus pragmatique. Je suis content de voir qu’il y a encore des universitaires qui ont les pieds sur terre
Je me suis un peu emporté plus tôt. Mais les structures sont à ce point coulées dans le béton que je n’entrevois même pas comment on peut espérer les modifier de manière significative. C’est devenu une telle machine bureaucratique que j’en suis à espérer l’avènement d’une solution parallèle. Personnellement, je crois que l’émergence de la dimension sociale des nouvelles technologies constitue un fameux vers une éducation affranchie des contraintes administratives, du moins pour ceux qui en ont les moyens.
C’est vrai que mon idée a des airs d’utopie. Quand on regarde le monstre qui est devant nous, l’ombre est telle qu’elle laisse filtrer bien peu de lumière! La nature systémique du problème fait en sorte que la situation est bien complexe à gérer mais, en meme temps, chacun individu dispose d’un potentiel d’action. Avec plus de concertation, on peut, je crois, espérer parvenir à faire bouger certaines choses en mettant à contribution ce que tu appelles les structures parallèles émergentes.
Quant aux universitaires qui ont les pieds sur terre, qu’est-ce que c’est que cette idée préconçue?
Ce que je trouve encourageant, à long terme, est cette idée que les « les structures parallèles émergentes » reposent déjà sur la concertation. Naturellement, elles sont issues des nouvelles technologies de la communication, lesquelles tendent à la collaboration, sinon à la coopération.
Pour ce qui est d’avoir les pieds sur terre, ce n’est pas tant une « idée préconçue » qu’une observation. Mais une description incomplète, j’en conviens. Comme, par ailleurs, tu as la tête dans les nuages, je trouve que ça fait un équilibre imprévisible.