Connaître la connaissance
Les nouvelles technologies de l’information n’ont pas tant changé la nature de la connaissance comme transformé l’usage qu’on en fait. En marge des modèles traditionnels de classification et de hiérarchisation, les connaissances sont dorénavant soumises à la dynamique internet des réseaux sociaux et des écosystèmes. Personne ne l’a mieux compris que George Siemens, le père du connectivisme. Siemens revient à la charge avec Knowing Knowledge, un livre qui explore l’impact des nouvelles technologies de la communication sur les connaissances, tant pour les corporations que les institutions scolaires (elearnspace : Knowing Knowledge – Book). Prêchant par l’exemple, Siemens offre son livre en trois formats : dans un wiki, en PDF téléchargeable (illustrations offertes sur Flickr), et en bouquin. De plus, il y consacre un site et un blogue.
Se peut-il que les nouvelles technologies modifient la nature des connaissances ? Je crois que oui. Dans la mesure où une connaissance est un phénomène, c’est-à-dire la conséquence d’une perception ou d’un raisonnement, elle dépend en grande partie de sa cause. Thalès de Milet a été le premier à reconnaître que la cause appartient à l’essence d’une chose, et particulièrement quand il s’agit d’un phénomène. Ainsi, dans un modèle hiérarchique et linéaire de transmission des connaissances, le rapport au savoir n’est pas le même que dans un environnement de diffusion élargie et d’accès libre.
Les connaissances issues de l’encyclopédisme ont une autorité qui tend à l’immuabilité. Elles revêtent le plus souvent une certitude qui ne souffre pas la contradiction. Celles issues du socioconstructivisme, au contraire, sont empreintes de doute ou, à tout le moins, de l’incertitude de la meilleure réponse qui soit. Cette incertitude transforme l’apprenant en chercheur. Et en participant.
La beauté des nouvelles technologies de l’information, c’est qu’elles maintiennent l’utilisateur sur le qui-vive. Obligé de valider l’information, il cherche et il partage, contribuant du même coup à la dynamique sociale de l’information. La quête de sens prend des dimensions communautaires. Le sujet participe à l’élaboration des connaissances. Du coup, ses chances d’intériorisation sont beaucoup plus grandes que si on le lui avait servi sur un plateau.
Entre une connaissance encyclopédique et une autre issue d’un réseau social, la différence de nature est sensible. La première, quoique plus certaine, est aussi plus statique. Elle est également plus intemporelle. Or, l’individu a besoin d’être rassuré quant à la contemporanéité de ses connaissances, ce que les réseaux sociaux font à souhait.
Par ricochet :
Au-delà du socioconstructivisme : le connectivisme
Le site du connectivisme
La puissance de la collectivité
5 composantes de la connectivité
Les technologies transforment l’apprentissage
Constructivisme vs connectivisme
Vous pouvez suivre les commentaires en réponse à ce billet avec le RSS 2.0 Vous pouvez laisser une réponse, ou trackback.

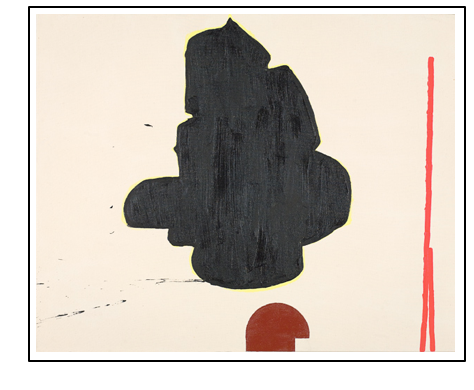
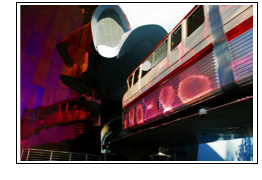

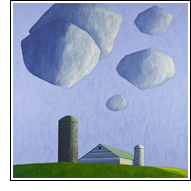

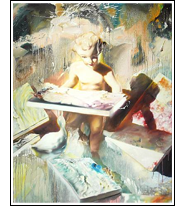


« Les connaissances issues de l’encyclopédisme ont une autorité qui tend à l’immuabilité. Elles revêtent le plus souvent une certitude qui ne souffre pas la contradiction. Celles issues du socioconstructivisme, au contraire, sont empreintes de doute ou, à tout le moins, de l’incertitude de la meilleure réponse qui soit. » Je ne suis pas nécessairement d’accord. Les connaissances acquises d’autrui peuvent facilement faire l’objet de dogme, selon la foi qu’on accorde à l’autrui en question.
« Obligé de valider l’information, il cherche et il partage, contribuant du même coup à la dynamique sociale de l’information. » Mais on voit que dans plusieurs cas, ce n’est pas ce qui arrive. J’ai l’impression qu’il y aura en fait de plus en plus une polarisation entre ceux qui entretiennent le doute et ceux qui recherchent les certitudes. Pour bien des gens, il demeure que « si c’est dans [le journal/la revue scientifique/wikipedia/le blog d'untel, etc.], ça doit être vrai ». Ce que le connectivisme permet, c’est d’apporter des outils à ceux qui reconnaissent l’utilité du doute
Si « l’individu a besoin d’être rassuré quant à la contemporanéité de ses connaissances », il a également (et peut-être même plus) besoin d’être rassuré quant à leur stabilité et leur certitude. En fait, tout revient à la quantité de doute que l’individu est prêt à entretenir dans sa vie. Plusieurs personnes ressentent un besoin de stabilité dans leurs connaissances (et croyance), ils veulent être sûrs du sol sous leurs pieds, en quelque sorte.
Il m’a fallu du temps pour répondre à ton commentaire, Marc André, car tes arguments ont du poids. La notion d’encyplopédisme est effectivement trop restrictive. Il faudrait plutôt parler d’autorité, ou de foi, comme tu le dis si bien. Je penche un peu trop facilement pour le jargon éducationnel. Tu fais bien de me reprendre. En passant, ton préambule au billet Crédit et foi est fort intéressant.
Tu as raison, également, de souligner la « polarisation entre ceux qui entretiennent le doute et ceux qui [entretiennent] les certitudes. » Je généralisais en m’intéressant à ceux qui s’adonnent au maillage électronique. Je crois que la majorité de ceux-là appartiennent à la première catégorie.
Pour ma part, (et je suis jeune, donc cela passera peut-être) j’ai le sentiment que nous acquérons de moins en moins de connaissances : j’emploie ici le terme de connaissance sous le sens de « savoirs sur les choses ».
En effet, l’avancée de nos connaissances rendent fausses, car partielles, les connaissances que nous pouvions tenir pour vrai il y a vingt, cinquante, ou cent ans suivant les disciplines. Mais ces connaissances « partiels » avaient pour principale qualité d’être assimilables, et de pouvoirs être retenues du fait du petit nombre de variables qu’elles manipulaient.
Aujourd’hui, même les spécialistes sont producteurs d’une connaissance qu’ils sont incapables d’assimiler. Les seules connaissances échappant réellement à ce phénomène étant les métas connaissances. Nous nous orientons donc de plus en plus vers une vie intellectuelle pour laquelle les connaissances sont manipulés « à l’extérieur de notre propre intellect », sur le papier : nous possédons plus les connaissances en propre. Nous les manipulons comme la matière, et même lorsque nous nous attaquons à un domaine parfaitement limité, elles sont pour ainsi dire « incompréhensibles ». ( ungraspable).
Cet état de fait, il me semble doit nous obliger à redéfinir, au-delà de l’opposition dogme/vérité « suspendue », les notions héritées que nous avons de la connaissance et du doute.
Très intéressante réflexion, Martin, qui ne trahit certainement pas votre âge.
Je crois qu’on idéalise le passé. Chaque époque comporte ses lumières, issues du contexte d’alors, et ampoulées par l’histoire (pour faire un mauvais jeu de mots). Surtout depuis l’avènement de a presse à imprimer, l’homme est submergé de savoirs. La différence aujourd’hui est d’abord marquée par une question de degrés. Cette spécialisation que vous soulignez est certainement plus aiguë, quoiqu’elle existe depuis la sédentarisation et l’émergence des métiers, il y a fort longtemps de cela.
Les savoirs ont toujours une valeur relative au contexte, qu’il soit passé, présent ou à venir. À l’instar des mèmes, nous les retenons ou évacuons progressivement en fonction de leur importance. Le fait que notre culture est marquée au fer du matérialisme et de la science, pour ne nommer que ces deux-là, fait en sorte que nos connaissances en sont teintées. Les mêmes connaissances, dans une autre culture, prennent un sens autrement nuancé.
Les savoirs les plus fondamentaux, à mon avis, ceux qui transcendent le particulier, sont ceux que nous procure la philosophie. Il est dommage que l’on ne l’enseigne pas davantage.