Le fichu bulletin de l'élève
 Il ne peut pas y avoir de totalité de la communication.
Il ne peut pas y avoir de totalité de la communication.
(Paul Ricoeur)
J’ai participé, coup sur coup, à deux journées de débats sur le fichu bulletin scolaire. La première, à l’école, portait sur l’absurde table de conversion des cotes en pourcentage. La deuxième, dont je sors au moment où j’écris ces lignes, s’attaquait à l’action du RAEQ devant l’intention de la ministre de l’Éducation de procéder à l’évaluation des connaissances. À la suite de cette double fusillade, j’en conclus que le bulletin, dans sa forme actuelle, est une relique d’une autre époque, mal adaptée surtout à une réforme. Néanmoins, il faut composer avec les circonstances.
Comme le disait Michel Laurier, doyen de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal, l’évaluation en éducation ne sera jamais qu’un compromis entre l’idéal et le possible, que délimite une panoplie de contraintes. Or, dans la triste réalité des compétences chiffrées et de la menace de l’évaluation des connaissances, il faut bien envisager une action politique. D’autres que moi sont plus aguerris à ces escarmouches et je leur laisse le soin de déterminer la tactique à adopter. Toutefois, je suis favorable à certaines idées exprimées :
- valoriser les connaissances en reconnaissant leur rôle dans la réalisation d’une compétence; l’emphase sur les compétences a eu un effet réducteur sur les connaissances;
faire valoir que les connaissances sont déjà évaluées par le biais des compétences;
faire preuve de prudence dans l’énumération des connaissances associées aux compétences afin de ne pas se prêter au jeu de la ministre et ouvrir la porte à une éventuelle évaluation desdites connaissances.
envisager l’évaluation de certaines connaissances dites essentielles, considérées dans une dualité ou un continuum connaissance-compétence, notamment au primaire.
Quoi qu’il en soit, l’idée d’évaluer les connaissances reliées à une compétence est une aberration, en raison de leur nombre. Sans compter le piège inévitable des connaissances déclaratives, au détriment des connaissances procédurales et conditionnelles (Jacques Tardif, 1992), voire stratégiques, comme le faisait remarquer Michel Laurier.
La bureaucratisation de l’évaluation a fait en sorte de créer un monstre. Le passage à un bulletin de huit pages, d’une page qu’il était, ne saurait être considéré comme un progrès quand on envisage toute l’énergie dépensée en amont pour sa réalisation, et en aval pour sa compréhension. D’autant plus que ce long diagnostic ne comporte aucune recommandation pronostique pour venir en aide à l’élève.
Les difficultés du bulletin s’inscrivent dans la foulée de celles associées à une réforme de l’éducation dont on a modifié le contenu, sans égard au contenant. Le bât blesse tant sur le plan de l’environnement d’apprentissage que du cadre organisationnel. À ces maux, il faut désormais ajouter le bulletin.
Foncièrement, le problème en est un de communication, dont le bulletin est un vecteur usé. Hormis la question de la reconnaissance des acquis en fin de cycle, le temps n’est plus aux communications épisodiques, comme l’école l’a toujours fait traditionnellement. Nous disposons aujourd’hui d’une panoplie de moyens Internet qui permettent de communiquer l’information au fil des événements et des évaluations. Une évaluation n’a jamais plus de sens qu’au moment de sa concrétisation; pour le parent, elle permet une action rapide. Tôt au tard, la formalité et le décalage du papier vont devoir céder le pas à l’instantanéité de l’électronique. C’est d’ailleurs ce que nous avons cherché à accomplir avec Lumi.
(Image thématique : Weather Report, par Mary Heilmann)
Par ricochet :
Bulletins scolaires : chiffres, lettres ou descriptions ?
Moderniser l’évaluation / visualiser’ la pensée
Vous pouvez suivre les commentaires en réponse à ce billet avec le RSS 2.0 Vous pouvez laisser une réponse, ou trackback.

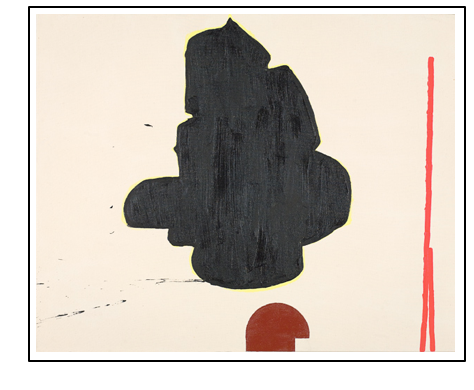
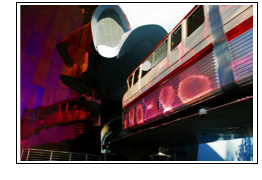

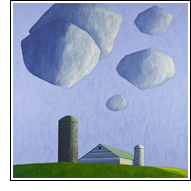

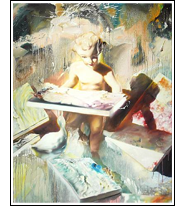


Permettez-moi ce commentaire que je placerai également sur le blogue du RAEQ, pour fins de discussion, M. Guité.
En français, nous mesurons des compétences: savoir écrire, par exemple. Les grilles de correction que nous utilisons accordent évidemment des «points» ou des «cotes» pour le fond (les idées), la structure, le vocabulaire et la qualité de la langue. Or, ce que l’on remarque, c’est qu’il est tout à fait possible pour un élève ayant très peu de connaissances quant au code grammatical de réussir une telle épreuve. Pourquoi? Je prendrai exemple sur l’examen final d’écriture du MELS de cinquième secondaire, mais il faut savoir que ceux des autres niveaux sont construits sensiblement sur la même logique.
Premièrement, et on ne le dira jamais assez, la correction de cet examen est peu sévère. Pour le MELS, l’élève a toujours raison et c’est au correcteur de prouver qu’il est dans l’erreur, même si son propos est peu clair. Un élève qui répond «en partie» à un critère obtient déjà la moitié des points attribués à ce dernier en partant.
Deuxièmement, les critères en ce qui concernent la maîtrise de la langue sont de véritables passoires. À ce sujet, le MELS a dû, il y a quelques années, fait croire qu’il a rajusté le tir. Ainsi, on est passé d’un élève qui pouvait écrire 200 fautes de grammaire et d’orthographe et réussir cet examen à un élève qui peut faire une faute de grammaire et d’orthographe aux 14 mots. Appelons cela, par dépit, une amélioration. Dans les faits, le guide du correcteur, avec diverses exceptions permet davantage d’erreurs.
Il importe de souligner que ce seuil de réussite (ou d’échec, c’est selon) n’existe qu’en cinquième secondaire. Pour les dix autres années d’enseignement du français, la débandade est permise et trop souvent sans aucune conséquence, sauf celle de découvrir qu’on ne sait pas écrire correctement sa langue maternelle à l’âge de 16-17 ans.
Troisièmement, ce type d’évaluation ne permet pas de mesurer si un enfant a une bonne maîtrise du code grammatical. Il permet seulement de mesurer s’il sait écrire un texte argumentatif de 500 mots potable sans faire une haute aux 14 mots. Point à la ligne. Avec des techniques d’évitement et une grille de correction complaisante, 85% des élèves québécois réussissent cette épreuve, même s’ils confondent encore «leur» pronom et «leurs» déterminant après onze années à l’école. On ne parle pas ici d’exceptions rares que certains se plaisent à évoquer pour expliquer la complexité de notre langue. De plus, il faut également savoir que toutes les évaluations d’écriture au Québec PERMETTENT à l’élève d’utiliser une grammaire et un dictionnaire. Avec ou sans réforme.
L’évaluation est une chose complexe, qu’on mesure des connaissances ou des compétences, ou même les deux. Il est inconcevable que la réforme, avec toute l’énergie et les moyens qu’elle a nécessité, permette encore à des jeunes de réussir sans maîtriser le code grammatical. Savoir écrire correctement sa langue maternelle n’est pas un concept ringard ou désuet.
Le débat n’est pas simple, mais en français, comme dans d’autres matières, il est faux de croire que les évaluations que nous avons connues, et encore plus dans le cas de celles de la réforme, permettent d’évaluer correctement les connaissances. Dans la plupart des cas, elles ne visent qu’à les faire réussir et à leur décerner un diplôme sans égard ce qu’ils connaissent vraiment. Et pour ceux qui invoqueraient que les programmes actuels sont plus exigeants que les précédents, venez voir au quotidien ce qu’on nous demande d’exiger des élèves pour qu’ils «réussissent». Il y a tout un écart entre certains rêves ministériels et la réalité.
Je suis très sensible aux difficultés qu’on éprouve dans l’enseignement de la langue maternelle. Sans doute y a-t-il lieu de resserrer les efforts sur le plan de la grammaire et de la syntaxe, mais ce sont là des détails de pondération qui découlent davantage des modalités imposées par le MELS que de l’approche par compétence, laquelle repose entre autres sur des connaissances. Les lacunes sur le plan du code grammatical que vous soulevez ne sont pas qu’un problème de connaissances; elles relèvent également d’une absence de stratégies pour y remédier. Ça n’explique pas tout, évidemment; il y a aussi le manque de valorisation et, par conséquent, de motivation à apprendre une langue soignée. Il est illusoire d’espérer que l’ensemble d’une population maîtrise un code grammatical, d’autant plus à une époque où la langue usuelle est en pleine transformation. Vous avez une tâche ingrate.
La langue fait nécessairement appel à des compétences. Or, celles-ci s’acquièrent au fil du temps, dans un long processus. Notre responsabilité consiste à faire progresser les élèves au mieux de nos capacités, et non de faire en sorte que chacun atteigne l’ensemble des objectifs. On ne saurait être tenu responsable des retards des élèves. Par ailleurs, l’idée d’arrêter l’élève dans son processus d’apprentissage n’est plus envisageable. Le redoublement, c’est bien démontré, n’est pas une solution. Aussi difficile que cela rende notre tâche, il faut tenter de servir l’élève. Toutefois, des mesures d’appui peuvent grandement aider à la tâche.